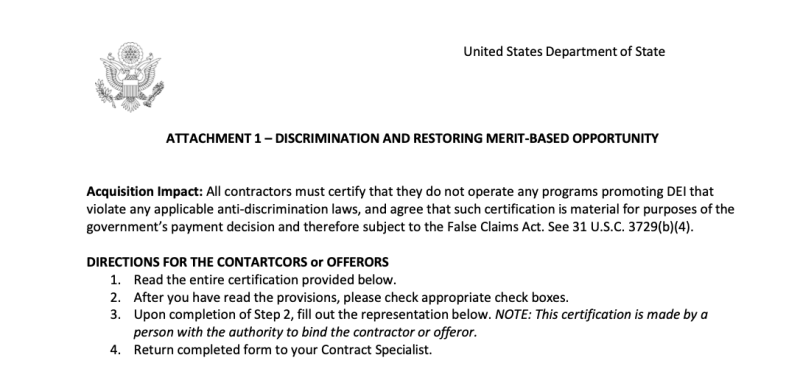“On ne peut plus rien dire !”, cette phrase si souvent prononcée dans la vie du quotidien exprime en creux la lassitude de la part de certains individus face aux luttes de genres. Ce phénomène, appelé la gender fatigue dans la littérature anglo-saxonne prend de plus en plus de place et décrédibilise le discours des militantes et militants du genre.
Par Selma Chougar
Dans une vidéo TikTok datant d’octobre 2023 et largement repostée par PAINT, Anastacia, une jeune influenceuse française explique ne pas comprendre pourquoi la gay pride existe encore, elle interroge : “Quels droits actuellement en France vous ne possédez pas et que nous, les hétéros, possédons ? Vous pouvez avoir le permis, vous marier, adopter, travailler, acheter ce que vous voulez, donc je ne comprends pas à quoi sert cette Pride si vous avez déjà les mêmes droits que les personnes dites hétéros cisgenres”. Des milliers de vues et de likes plus tard, de nombreux commentaires approuvent les propos de la jeune femme et expliquent leur fatigue face aux revendications LGBTQI+.
On pourrait penser que cela concerne une petite minorité d’internautes sur TikTok, mais l’on voit apparaître ce discours aussi sur LinkedIn, où Sabine Lefebvre* , une attachée de presse quadra très suivie, s’insurge : “Je n’en peux plus de ces wokes, de cette tyrannie des petits ressentis de minorités”, elle ajoute dans un autre post : “Tout devient impossible, la création artistique, la littérature, les rapports humains, la séduction, le rire. (…) Même JK Rowling ne pourrait plus écrire Harry Potter parce que ses héros sont genrés”. À la veille de la Saint-Valentin, elle affirme vouloir : “Sauver et défendre l’amour dans la France de Mona Chollet, de Caroline de Haas et du révisionnisme amoureux”.
Sabine Lefebvre ne se sent ni LGBTphobe, ni sexiste, elle dit être en faveur de la diversité et de l’inclusion de ces minorités, pourtant elle considère que les luttes de genres sont contre-productives : “On prend en compte beaucoup trop d’individualités et on ne comprend plus rien”. Même son de cloche du côté de Gérard Petit*, un quinqua interrogé qui dit se sentir censuré par les luttes de genres : “On ne peut plus rien dire sinon on se fait immédiatement traiter de misogyne ”.
Alors comment expliquer ces discours ? Selon l’enseignante-chercheuse anglaise Elisabeth Kelan, il s’agit d’un phénomène bien particulier, celui de la “Gender fatigue”, autrement dit, la lassitude face aux luttes féministes et LGBTQI+. Une fatigue à double tranchant, d’un côté celles et ceux qui estiment que de nombreux progrès ont été réalisés concernant les luttes de genres et qu’il faudrait à présent arrêter d’en parler, et de l’autre l’épuisement des militants et militantes qui estiment que les progrès ne se font pas assez rapidement.
La multiplication des luttes face à la défense d’un équilibre culturel
Bien qu’il n’y ait pas encore en France de véritable spécialiste du phénomène des gender fatigue, on peut observer plusieurs tendances qui expliqueraient ce ras-le-bol des questions de genres. Selon le sociologue spécialiste des questions LGBTQI+, Arnaud Alessandrin, il faut interroger la place des hommes hétérosexuels dans ces débats : “Un grand nombre d’hommes vont mettre en avant l’idée qu’on en parle trop et qu’il y a plus central. Pour certains, les éléments matérialistes et les questions sociales telles que l’économie ou la politique seraient plus importantes que les questions sociétales.”, affirme le sociologue. On a donc une opposition voir une hiérarchisation entre questions sociales et questions sociétales.
Si certaines études montrent que les hommes hétérosexuels seraient plus réfractaires à ces questions de genre, en réalité, la gender fatigue touche un public assez large dont les motivations divergent : “La gender fatigue c’est aussi chez des femmes lambda avec des mouvements anti-féministes qui considèrent que le féminisme à déjà conquis l’égalité, que les féministes en font trop et que ça dessert la cause d’en parler”, explique Arnaud Alessandrin. La question de la centralité des questions de genre, du combat déjà acquis, mais aussi du jugement contre productif des luttes LGBTQI+ et féministes semblent trois façon de dire la fatigue du genre.
S’ajoute à cela les discours de la banalité – que l’on a toutes et tous déjà entendu – chez certains hommes par exemple qui disent ne pas se sentir concernés : “Je ne suis pas comme tous ces hommes, donc le hashtag metoo ne me concerne pas”, mais aussi chez certaines femmes qui estiment que : “à force de parler de féminisme, on aura plus d’hommes”. Selon Arnaud Alessandrin, ces échanges en famille et entre collègues ne sont pas de simples échos aux discours de certains médias : “Cela résonne dans des discussions banales du quotidien”, souligne t-il.
La véritable nouveauté aujourd’hui concerne la polarisation des positionnements politiques. D’un côté il y a une démultiplication des revendications et de l’autre côté, il y a un durcissement de l’idée de frontière : “Avant, il y avait le féminisme et les questions gay, aujourd’hui, on a les questions intersectionnelles, les questions féministes associées aux questions environnementales, les questions trans, les questions des jeunes trans, des personnes non-binaires”, souligne le sociologue du genre. Tandis que du côté conservateur : “Ils ont le sentiment de perdre du pouvoir, de perdre la tradition, de perdre un équilibre culturel et il s’agit de le défendre”, appuie Arnaud Alessandrin.
Résultat, on se retrouve avec des personnes qui sont très convaincues des questions d’égalité, et qui, en évoquant ces questions n’arrivent pas toujours à convaincre, à acculturer autour d’eux à l’égalité, c’est plutôt l’inverse, ils finissent par fatiguer. Alors vient la question de la pédagogie, comment faire pour parler sans cesse d’égalité, puisque l’égalité n’est pas atteinte, sans provoquer un sentiment de saturation chez les gender fatigués ?
L’épuisement des chargés de D&I en entreprise
Alexia Séna, fondatrice de Joyeux Bazar, une agence de conseil et de sensibilisation qui accompagne les organisations pour les rendre plus respectueuse des différences, offre quelques éléments de réponse dans son atelier en entreprise qu’elle a nommé volontairement On ne peut plus rien dire : “Dans cette formation, on va décortiquer cette phrase, c’est qui “on” ? Quand on dit “ne peut”, qu’est ce qui nous empêche réellement ? “plus”, ça veut dire que l’on pouvait avant, qu’est ce qui a changé ?”, explique t-elle et ajoute : “Cela amène les gens à vraiment creuser et regarder en face cet inconfort”.
C’est donc plusieurs types d’inconforts qui s’expriment à travers l’habituel “on ne peut plus rien dire”. À la fin du module elle propose de reformuler la phrase de façon plus précise, plusieurs éléments sont alors mis en évidence : “Je n’ai pas le vocabulaire donc dès qu’on commence à parler de personnes non-binaires, de personnes trans, je suis perdu donc ça me soule” ; “à chaque fois qu’il y a une conversation là-dessus ça se termine en dispute et moi je n’ai pas envie de passer un mauvais moment à table” ; “à chaque fois que je vais dire quelque chose on va me traiter de gros boomer hyper réac”. Une myriade de ressentis individuels.
Un discours qui démoralise les professionnel·les de la diversité et de l’inclusion et finit par affecter leur santé mentale. Pour la consultante en D&I, une seule solution, parler moins et agir plus : “Continuez à en faire autant, faites en même plus parce qu’il y a du travail, mais parlez moins. Appliquez une politique de tolérance zéro, au moindre signalement on ouvre une enquête et s’il faut virer quelqu’un, même s’il fait 40% du chiffre de la boîte, on va le virer, ça n’a pas besoin d’être bruyant.” Preuve que le combat n’est pas terminé.
*Les noms ont été changés