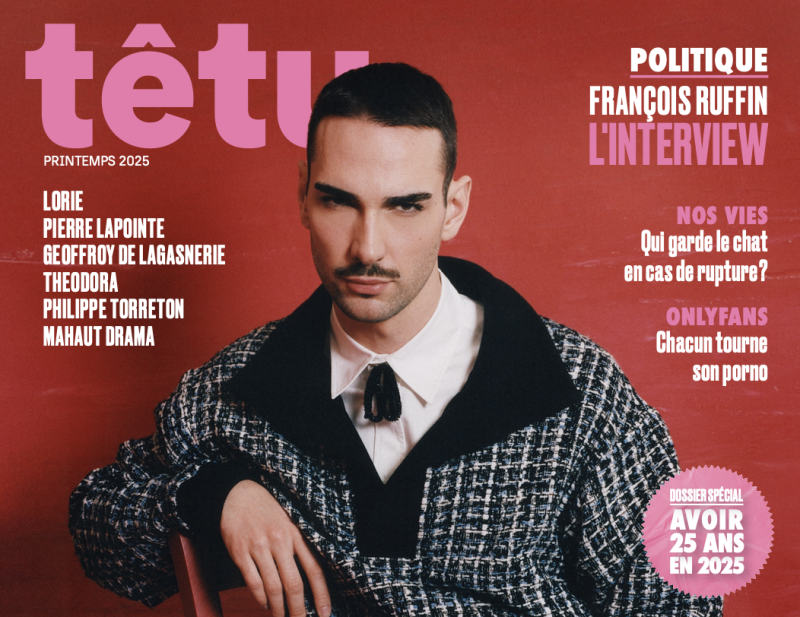Dans un contexte où les débats autour de la pensée woke se crispent, têtu•connect vous propose de revenir aux origines de ce concept aujourd’hui largement vidé de son sens originel. Le temps d’un dîner-débat, nous avons invité deux expertes du sujet : Marie-Lou Dulac, consultante, conférencière et autrice du livre : Décrypter "la pensée woke" dans la pop culture (Éditions EMS) et Marie-France Malonga sociologue, spécialiste des médias. À leurs côtés, Pascal Demurger, Directeur général du groupe MAIF revient sur l’importance du rôle sociétal de l’entreprise.
Par Chloé Consigny
« À l’origine, le terme “woke” est utilisé pour décrire une conscience sociale accrue, notamment en ce qui concerne les discriminations raciales et les droits civiques. Au fil des années, la notion de “woke” a évolué pour englober un large éventail de luttes, y compris celles liées au féminisme et aux droits des personnes LGBTQI + », explique Marie-Lou Dulac. Si le terme woke vient des Etats-Unis, son origine, en revanche, est largement antérieure à l’affaire George Flyod, cet afro-américain tué en par un policier en mai 2020 lors de son arrestation à Minneapolis. Dès 1896, Booker T. Washington – ancien esclave devenu professeur – évoque une idée d’éveil dans sa publication « The Awakening of the Negro ». Un premier appel à l’éveil qui se poursuivra ensuite aux Etats-Unis et plus particulièrement au sein de la communauté afro-américaine. En 1931, à la suite de l’affaire des Scottsboro Boys, le chanteur afro-américain Lead Belly livre sa chanson en hommage à ces hommes noirs jugés dans un procès expéditif, et invite les noir·es américain·es à « rester éveillées dans l’Alabama ». En 1962, l’essai de William Melvin Kelly « If you are woke You dig It » paraît dans le New York Times.
Islamo-gauchisme et éco-terrorisme
D’autres mouvements sont ensuite venus s’ajouter, jusqu’à ce que le mot woke fasse partie du vocabulaire courant. Après les Etats-Unis, le terme woke a débarqué en Europe et notamment en France par le biais des médias. Cependant, le terme s’est immédiatement doté d’une connotation négative avec le mot wokisme, comme l’explique la sociologue spécialiste des médias Marie-France Malonga. « Le mot wokisme est apparu en France avec le vocabulaire de la contagion et de l’infection. Qualifié d’abord de « nouveau virus de la pensée » par les médias, un glissement sémantique s’est opéré et le wokisme est devenu le cousin germain de l’islamo-gauchisme et de l’écoterrorisme ». Une évolution qui a conduit à une perception très négative du wokisme en France où le terme est désormais assimilé à une menace contre l’ordre établi. « Il faut distinguer le mot woke du mot wokisme. En France, le wokisme est un fantasme des franges les plus conservatrices, voire les plus réactionnaires de la société, qui voient l’ensemble de ces mouvements en faveur de la justice sociale comme un mouvement homogène, une sorte de confédération de gauche qui viserait à renverser la liberté d’expression, l’ordre établi et la méritocratie. Seules les revendications considérées comme les plus abusives ou les plus ridicules sont relayées », explique Marie-Lou Dulac.
Progrès social
Pourtant, chaque mouvement qualifiable de « woke » revêt un part légitime de contestation. « Lorsqu’un individu est discriminé et stigmatisé, il est légitime de contester cette domination », souligne Marie-France Malonga. Et de fait, ces mouvements woke ont permis des avancées notables. « Prenons l’exemple des médias », poursuit Marie-France Malonga. « Les directeurs et directrices de chaîne de télévision ne se sont pas levé·es un matin en se disant qu’ils et elles allaient donner davantage l’antenne aux populations issues de minorités ou racisées. C’est grâce aux mouvements de revendication et notamment aux associations de professionnel·les des médias que les différentes représentations médiatiques ont évolué ».
Universalisme républicain
Un autre point soulevé lors de cette rencontre est la question de l’universalisme républicain à la française, souvent opposé à un wokisme qualifié de « communautariste ». « Il faut bien avoir à l’esprit que l’universalisme, bien qu’il soit un principe fondamental de la République, a souvent été appliqué de manière inégale, laissant de côté les spécificités des identités individuelles », détaille Marie-France Malonga. Cette tension entre l’universalisme et la reconnaissance des identités minoritaires est désormais au cœur des débats sur le wokisme. Pour Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, un chemin de compatibilité est possible entre ces deux mondes. « L’universalisme républicain à la française a été une force émancipatrice extrêmement puissante. Cependant, cet universalisme n’a pas corrigé les inégalités. Aujourd’hui, l’universalisme républicain devient daté et ne règle plus les problèmes contemporains ». Si la méritocratie est souvent citée comme l’une des grandes avancées de l’universalisme républicain, les trois intervenants s’accordent à dire que cette méritocratie profite largement à la frange dominante de la population.
Woke l’entreprise ?
De quelle façon, cet éveil à l’autre peut-il infuser dans l’entreprise ? Pour le dirigeant du groupe Maif, tout a débuté avec la remarque de l’une de ses collaboratrices. « Elle m’a expliqué que mes choix et mon comportement avaient un impact sur le corps managérial et sur l’ensemble des salarié·es. J’ai alors pris conscience que j’avais une petite responsabilité sur la façon dont mes collaborateurs et collaboratrices se sentaient ». À partir de cette date, le groupe s’est engagé dans une révolution managériale, quasi culturelle, mettant en place un management par la confiance et une attention forte portée à l’autre. L’an dernier, le groupe a par exemple mis en place un accord d’entreprise permettant aux personnes en parcours de transition de bénéficier de jours de congés supplémentaires. Des accords particulièrement bien accueillis en interne. Le dirigeant d’entreprise s’engage aujourd’hui au travers du mouvement Impact France qui regroupe 15 000 entreprises et dont l’objet est d’inciter les entreprises à s’engager. Un rôle sociétal de l’entreprise qui est une réelle nécessité pour le dirigeant. Car de fait, pour qu’il fonctionne, l’éveil doit s’opérer dans les deux sens. « Woke est un très joli mot. Même si cela donne des crises cardiaques aux communicants des chaînes de Bolloré, le fait d’être woke est une très bonne nouvelle. Je préfère personnellement des citoyens éveillés que endormis. Les populations socialement ou politiquement minorisées qui sont éveillées sur leurs conditions ont pour objectif de réveiller celles et ceux qui ne voient pas les inégalités. Pour ces populations plus privilégiées, la prise de conscience peut amener à davantage d’inclusion », conclut Marie-France Malonga.